L’Afrique doit développer sa résistance aux chocs
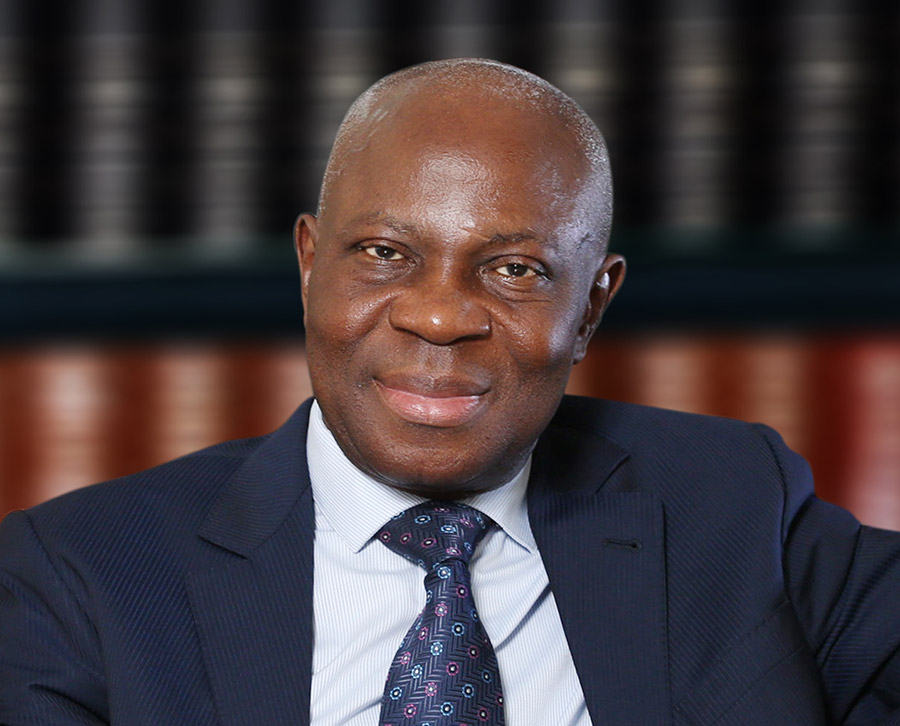
Gilbert Houngbo
Président du FIDA
Qu’en est-il de la crise alimentaire que le Covid-19 fait craindre ? Le président du FIDA nous dit où en est l’Afrique.
À propos de l’Afrique, la principale crainte à ce jour, au-delà de la crise sanitaire du Covid-19 et des conséquences économiques désastreuses qui vont en découler, c’est la crise alimentaire. Celle-ci est rendue probable par la déstabilisation d’économies qui vont passer de taux de croissance prometteurs à une récession qui va impacter tous les programmes, et surtout les populations les plus fragiles extrêmement nombreuses dans le secteur informel. Pour rappel, celui-ci se caractérise par des unités de production opérant typiquement à petite échelle, avec un faible niveau d’organisation, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production et avec l’objectif premier de créer des emplois et d’engendrer des revenus pour les personnes concernées.
Selon le rapport mondial sur les crises alimentaires publié le 21 avril dernier, en 2019, 183 millions de personnes étaient classifiées comme étant en situation de stress, c’est-à-dire entre la faim aiguë et le risque de tomber dans une situation de crise ou, pire, en cas de choc ou de facteur de stress comme la pandémie du Covid-19. Plus de la moitié des 135 millions de personnes (près de 73 millions) concernées par le rapport vivent en Afrique, un continent qui cumule les principaux facteurs renforçant les risques de crise. Ceux-ci sont les conflits, par exemple, dans le Sahel gangrené par le terrorisme, le changement climatique, principale cause, par exemple, de l’invasion des criquets en Afrique de l’Est, et les turbulences économiques qu’on observe avec la crise du Covid-19.
Parmi les organismes en première ligne, il y a le Fonds international de développement agricole (Fida), institution financière spécialisée des Nations unies, qui lutte contre la pauvreté et la faim dans les zones rurales des pays en développement. Son président depuis 2017, Gilbert Houngbo, s’est confié au Point Afrique à propos de l’insécurité alimentaire telle qu’elle est sur le terrain en Afrique en cette période troublée de crise sanitaire du Covid-19.
Derrière la crise sanitaire du Covid-19, y a-t-il des signes avant-coureurs de crise alimentaire que vous avez repérés ?
En réalité, je répondrai oui et non. Ce qui est sûr, c’est que la situation était tendue. Depuis les années 2000-2005, le nombre de personnes mal nourries ou qui souffrent d’insécurité alimentaire est en diminution. Chaque année, les cinq agences concernées, c’est-à-dire nous, le Fida, avec la FAO, le PAM, l’Unicef et l’OMS, produisons un rapport complet autour de l’insécurité alimentaire dans le monde. On a observé que la situation s’améliorait. Mais depuis 2015, le phénomène est reparti à la hausse sur le nombre de personnes en situation de famine dans le monde. Pour rappel, avant la pandémie, il y avait déjà 821 millions de personnes dans le monde qui, chaque jour, n’arrivaient pas à se nourrir. La situation nutritionnelle était aussi alarmante. Si on se réfère à la crise alimentaire de 2008, il y a une deuxième différence. Elle est liée au fait que l’état de l’offre globale au niveau mondial ne souffre pas vraiment de pénurie.
Au cœur de la crise alimentaire, il y a les catastrophes naturelles (criquets, par exemple), mais aussi la logistique à l’arrêt qui bloque l’approvisionnement. Avez-vous la main sur cette dimension du problème ? Si oui, qu’envisagez-vous de faire ?
Cette crise se joue à plusieurs niveaux. Si on regarde toutes les composantes, l’impact sur la chaîne alimentaire mondiale est déjà significatif de la production jusqu’à la table du consommateur. Au niveau de la production, les pays qui doivent semer et planter n’ont pas accès aux semis, aux intrants et aux engrais. Cette situation a un impact direct sur la productivité et la production. Au niveau de la transformation des produits, d’autres pays doivent récolter, mais n’ont pas les instruments ou les consommables pour le faire. Là aussi, on est face à une situation bloquée. Au niveau des producteurs, il y a les cas où ils ont déjà bien emballé leurs produits. Problème : il manque des camions pour les amener dans les marchés des localités voisines ou des grandes villes. Quand cet obstacle est franchi et que les camions arrivent en ville, ils se heurtent à la fermeture des restaurants ou à des hôtels qui sont leurs principaux clients. Résultat : faute d’alternative, ils jettent la marchandise. Le blocage est également une réalité quant aux exportations puisque les aéroports aussi sont fermés. Au final, l’impact de tous ces blocages est tellement fort qu’il en résulte une situation de pénurie généralisée.
Face aux causes conjoncturelles, quel type de mobilisation envisagez-vous et à quel niveau estimez-vous les montants financiers nécessaires ?
Il est d’abord très important de ne pas imposer notre façon de penser aux pays dans lesquels nous intervenons. Cela nous conduit à avoir une discussion approfondie avec les gouvernements. Le fait d’intervenir dans près de 60 à 70 pays qui ont demandé des appuis nous conduit donc à dialoguer avec chaque État sur ses particularités.
À partir de là, nous avons élaboré plusieurs niveaux d’intervention.
D’abord, il y a des projets qui sont en cours. Nous devons faire preuve de la plus grande flexibilité pour réaffecter ou rééquilibrer les budgets alloués, et ce, afin de régler les problèmes en cours. Dans le même temps, nous devons toujours garder à l’esprit que nous ne sommes pas une agence humanitaire.
Ensuite, nous avons un fonds pour faciliter. Nous l’avons doté de 40 millions de dollars et essayons d’attirer les donateurs étatiques et privés afin de mobiliser le plus de ressources exceptionnelles possible.
Enfin, nous suivons et participons aux échanges entre les institutions internationales, comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Notre objectif est de nous y assurer que nous pouvons nous aligner, les débats nous intéressant le plus étant ceux qui portent sur la question de la dette.
Dans le contexte actuel, les pays du Nord ainsi que les bailleurs de fonds sont très sollicités. De quelle marge de manœuvre disposez-vous pour régler ce problème qui met sous tension tout un continent ?
Effectivement, la marge de manœuvre est très serrée. En effet, les pays du Nord, qui sont souvent les donateurs, sont confrontés à un risque de récession économique comme tous les pays du monde. Cela pourrait avoir un impact direct sur l’aide au développement, d’où la nécessité d’être désormais innovant. Cela implique que nous regardons toutes les facilités que nous avons. Certains de nos programmes étaient encore dans le pipeline en phase conceptuel avant la pandémie. Nous allons tout simplement les réétudier pour réaffecter les ressources vers les urgences. Cela dit, malgré nos interventions, la situation est toujours périlleuse. Ce qui signifie que le risque que des pays commencent à déclarer officiellement une situation de famine est réel. Quoi qu’il en soit, nous devons augmenter nos interventions aux côtés des autres institutions internationales, des pays eux-mêmes et de toutes les bonnes volontés pour lutter contre cette pandémie, notamment en milieu rural où des institutions comme le Fida interviennent et où vivent 80 % des personnes pauvres de la terre.
Quelles solutions pourraient être mises en œuvre qui positionneraient votre organisation non plus comme un pompier, mais comme un accompagnateur des politiques agricoles des différents pays africains ?
En ce moment, dans nos interventions, nous discutons avec les autorités afin de nous assurer que les objectifs prévus pour le monde rural sont adaptés à la situation.
Cette crise alimentaire n’est-elle pas aussi et surtout une crise structurelle, une crise de l’organisation même de l’agriculture africaine, également une crise de la place de l’agriculture africaine dans l’agriculture mondiale ?
Je suis tout à fait d’accord avec vous. Crise structurelle ou pas, les pays africains n’ont pas assez de réserves, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Et j’utilise ce terme au sens large. Si vous regardez la plupart des pays de l’OCDE, dont de nombreux pays européens, les banques centrales ont très vite annoncé des actions très fortes pour soutenir les économies. Le problème pour l’Afrique est que la marge de manœuvre monétaire n’est pas aussi large. Il en est de même au niveau budgétaire. Les banques centrales africaines ne sont pas assez solides pour engager des actions de grande envergure à même de leur permettre d’endiguer ou de prévenir les conséquences de cette crise, et ce, d’autant que certains de leurs pays étaient déjà en crise, comme a eu à le signaler le docteur Ibrahim Mayaki, qui craint pour les pays du Sahel une superposition de plusieurs crises : alimentaire, sécuritaire et économique, entre autres. Autant d’éléments qui pourraient les fragiliser encore plus et creuser les crises structurelles.
Sans compter qu’il y a notamment ce problème de fermeture de frontières d’un pays comme le Nigeria qui impacte énormément les pays voisins du Sahel…
Le problème que le Nigeria a avec ses voisins existait déjà avant la crise du Covid-19. Nous appelons de toutes nos forces les pays qui ont fermé leurs frontières, pas seulement le Nigeria mais également les autres, à reconsidérer leur décision et à comprendre combien cela est un problème sur la chaîne alimentaire de la zone. Pour le Nigeria, ce sont essentiellement des pays de la Cedeao qui en pâtissent, car le Nigeria est un gros marché pour ses voisins. C’est dire l’impact qu’a cette décision qui s’inscrit dans la logique d’une politique volontariste du pays d’accroître sa production locale et de réduire ses importations alimentaires. Cela dit, au regard de l’adage selon lequel « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », je ne peux qu’appeler le Nigeria, le Bénin et le Niger à trouver une solution à ce problème qui pèse sur l’économie de la sous-région.
Où en est la concrétisation de la déclaration de Maputo de 2003 qui recommandait que, dans un délai de cinq ans, les États africains consacrent 10 % de leur budget à l’agriculture ?
La déclaration de Maputo de 2003 a été suivie par celle de Malabo. Et là-dessus, il faut dire que l’Union africaine, notamment la Commission de l’agriculture, a fait beaucoup pour le suivi et a poussé les pays au respect de cette déclaration, notamment sur la question de consacrer les 10 % du budget national à l’agriculture. De mon point de vue, les progrès enregistrés sont plutôt bons. Des avancées appréciables ont été constatées dans des pays comme le Mali et le Rwanda. Par ailleurs, il y a même des pays qui ont dépassé l’objectif de 10 %. Tout cela est encourageant, même si, pour l’ensemble du continent, beaucoup reste à faire.
Quel schéma l’Union africaine et les pays africains sont-ils en train de mettre en place sur le plan agricole et alimentaire dans le sillage de la zone de libre-échange africaine ?
C’est peut-être trop tôt pour développer sur un plan précis. Mais nous suivons les discussions menées au niveau global. La mise en œuvre des accords poursuit son chemin, même si la pandémie est venue un peu couper l’élan initial. Pour le moment, il a été décidé que le secrétariat de la Zleca sera basé à Accra, au Ghana, et que le sujet de l’agriculture, qui est majeur pour l’Afrique, va être intégré progressivement ainsi que tout ce qui concerne le commerce des produits agricoles.
La crise qui menace pose le problème de la création de valeur agricole de l’Afrique et celui du développement de son industrie alimentaire. Alors que les organisations multilatérales vont avoir de plus en plus de mal du fait du désengagement des États-Unis de nombreux programmes, qu’avez-vous actuellement en chantier qui puisse créer un cercle vertueux alimentaire ?
Les États-Unis se sont en effet désengagés de plusieurs programmes, mais pas au niveau agricole africain. L’Usaid, l’Agence des États-Unis pour le développement international, est très active au sein des agences onusiennes qui s’occupent de l’agriculture comme le Fida, le Programme alimentaire mondial (PAM), la FAO, etc. Le problème réside dans l’aide publique au développement qui n’a pas du tout augmenté, nous obligeant à contribuer encore plus pour au moins maintenir le niveau des montants consacrés à l’agriculture.
Quelles leçons devront être tirées de cette crise pour que l’après-Covid-19 ne soit pas comme l’avant ?
Il y a deux éléments fondamentaux au niveau des retombées socio-économiques :
– Le premier réside dans la résilience au niveau individuel, dans nos foyers, mais aussi dans la résilience institutionnelle et étatique. Lorsqu’il y a eu la crise financière de 2007-2008, la plupart des institutions financières dans le monde ont procédé au renforcement de leur capacité de résistance aux chocs financiers, notamment sur les circuits bancaires. En fait, l’Afrique doit développer sa résistance aux chocs. Je pense bien sûr aux chocs sanitaires liés aux pandémies, mais aussi aux chocs climatiques liés au réchauffement de la terre. L’une des meilleures illustrations est cette invasion de criquets qui continue de ravager l’Afrique de l’Est. Certes, les gouvernements ont réagi vite, sollicitant des appuis financiers de la FAO, de la Banque mondiale et du Fida entre autres, mais les ravages de cette invasion sont loin d’être circonscrits.
– Le second réside dans notre rapport aux technologies de la communication et de l’information. Si nous avons tous réussi plus ou moins à faire du télétravail, c’est surtout en raison du niveau technologique des différents pays où nous nous trouvons. On oublie trop vite que, dans les milieux ruraux, si beaucoup de personnes sont équipées de mobiles, la plupart ne sont pas équipées de téléphones intelligents ou smartphones. Le potentiel offert par une bande passante trop faible ne favorise pas l’élévation du taux de pénétration dans ces milieux, ce qui est un frein technologique, qui en entraîne d’autres. C’est donc le moment de réfléchir à des mesures alternatives dans les zones rurales et pousser à faire du digital rural une question centrale.
Propos recueillis par Malick Diawara et Viviane Forson
Source : www.lepoint.fr






